- +1(367) 380-3092
- projet.ustawi@forumjeunesseafroquebecois.org
- 435 rue du Roi, Québec, Québec, G1K 2X1, bureau 11
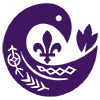
Lexique en santé mentale antiraciste


Trauma racial
Le trauma racial, selon Comas-Díaz et al. (2019), fait référence à un stress lié à la race que peuvent ressentir les personnes de couleur et autochtones (POCI) lorsqu’elles sont victimes ou témoins d’événements, réels ou perçus, de discrimination raciale. Ce trauma est la conséquence d’une longue histoire d’oppression et de marginalisation vécue par les personnes racisées, ce qui explique son caractère transgénérationnel. Il se manifeste par de l’hypervigilance, de l’anxiété sociale, de l’insomnie, ainsi qu’une méfiance manifeste ou latente envers les personnes non racisées et les institutions garantes de l’ordre social dominant. Les microagressions quotidiennes, le profilage racial et les barrières institutionnelles (dans l’éducation, la santé, etc.) peuvent, selon plusieurs études, entraîner un stress post-traumatique racial. Des exemples de trauma racial ont été étudiés dans le système éducatif canadien, où les étudiant·e·s noirs sont souvent perçu·e·s comme moins doué·e·s et, par conséquent, orienté·e·s vers des filières non scientifiques.
Deux véritables défis s’opposent à la guérison du traumatisme racial selon les études. D’une part, l’enracinement de ses blessures raciales dans un contexte sociopolitique et ses caractères continue et de l’autre ; les conceptions actuelles du traumatisme et du stress traumatique ainsi que les modèles de traitement sont ancrées dans des perspectives européennes de prise en charge.

Les tabous culturels liés à la santé mentale
Les tabous culturels liés à la santé mentale constituent un ensemble d’idées préconçues, de normes implicites et de comportements valorisés ou proscrits relatifs à la santé mentale dans un contexte social donné. Ces représentations influencent la manière dont les personnes perçoivent la santé mentale et la souffrance psychique. Parmi les tabous culturels les plus répandus au sujet de la santé mentale des personnes noires on peut citer l’association de la dépression à un signe de faiblesse, les noirs ne souffrent pas de dépression etc.

Stigmatisation liée à la santé mentale
Même si l’on constate un effort de dé-stigmatisation global autour de la santé mentale au Québec, il existe toujours plusieurs formes de stigmatisation en lien avec la santé mentale, dont les minorités ethnoculturelles, notamment les personnes noires, sont particulièrement victimes. Elles se manifestent par des préjugés persistants (résilience naturelle, force émotionnelle…), une méfiance envers les services, une minimisation de la souffrance psychique, une discrimination dans l’accès aux soins, et des diagnostics de santé mentale biaisés ou erronés. Cette stigmatisation est enracinée dans une histoire longue de racisme systémique, de marginalisation, de contrôle et de déshumanisation du corps noir. Elle contribue au non-recours aux soins, à l’isolement ethnique et à l’intériorisation de la souffrance chez les personnes noires. Par exemple, selon un constat de Santé publique Ontario, les personnes noires attendent 16 mois en moyenne pour obtenir des soins en santé mentale, contre 8 mois pour une personne blanche. Cette situation résulte de la peur d’être perçue comme étant en échec personnel, le manque de compétence culturelle, et les préjugés et biais inconscients des professionnels de la santé.

Oppression intersectionnelle
L’oppression intersectionnelle est une forme d’oppression particulière que subissent les personnes marginalisées en raison de leur appartenance à une ou plusieurs catégories sociales minoritaires. Plus une personne est à l’intersection de plusieurs groupes minoritaires (genre, race, orientation sexuelle) plus elles risquent de subir des discriminations croisées qui s’additionnent et se renforcent. L’oppression intersectionnelle peut se manifester par des micro-agressions, de la discrimination systémique, des inégalités et exclusions sociales. Une femme noire, lesbienne en situation de handicap risque de vivre du racisme, du capacitisme, du sexisme et de l’hétérosexisme qui s’entrecroisent et se renforcent créant une forme d’oppression particulière que l’analyse d’un seul aspect de son identité ne permettrait pas de saisir.

Micro-agressions raciales
Les micro-agressions raciales sont définies par Sue et al. (2007) comme des formes d’agressions subtiles et dénigrantes survenant lors d’interactions interpersonnelles brèves, de manière intentionnelle ou non, dirigées contre les personnes racisées en raison de leur appartenance à un groupe minoritaire. Elles peuvent prendre la forme de compliments ambigus sur les compétences, l’apparence physique ou les cheveux (ex. : « Tu parles bien pour un Noir », « Tu as de beaux cheveux longs pour un Noir », « Tu as une petite bouche pour un Noir »), de plaisanteries ou commentaires fondés sur des stéréotypes ou croyances erronées (ex. : « Tu ne peux pas te faire tatouer », « Tu es agressif » lorsqu’une personne noire s’exprime avec assurance, ou encore de propos maladroits tels que : « Ah, tu viens de tel pays ? C’est dur là-bas. Tu es bien ici à Québec… »
Selon les recherches de Cary S. Kogan et al. (2022), les micro-agressions raciales sont associées à une anxiété accrue chez les personnes noires, en raison de leur caractère répétitif, insidieux et souvent banalisé.

Le racisme systémique ou structurel
Le racisme systémique ou structurel peut être appréhendé comme une forme de discrimination intégrée aux structures sociales et institutionnelles, de manière intentionnelle ou non, fondée spécifiquement sur des motifs tels que la « race », la couleur, l’origine ethnique ou nationale, la religion et la langue. Le terme a été prononcé pour la première fois en 1984 à Montréal, à la suite d’un constat établi par la Commission des droits de la personne sur le niveau élevé de discrimination envers les Québécoises et Québécois d’origine haïtienne dans le milieu du taxi. Pour plusieurs chercheurs, la surreprésentation des communautés noires dans les centres de protection de l’enfance et les milieux carcéraux, l’arrachement des enfants autochtones à leurs familles pour les placer dans des pensionnats, ainsi que les abus sexuels, physiques et psychologiques subis par les femmes autochtones, constituent des expressions tangibles du racisme systémique dans la société québécoise et canadienne.
Dans le contexte de la santé mentale, ce racisme structurel ou systémique se manifeste par entre autres :
- La non-prise en compte de l’expression culturelle dans la compréhension des troubles mentaux,
- Le manque de professionnels issus de la diversité ethnoculturelle,
- La surdiagnostication de troubles comme la schizophrénie chez les populations noire
Toutefois, il n’existe pas de consensus au Québec sur l’existence du racisme systémique, même si des constats, rapports et études scientifiques indiquent que les institutions québécoises ont hérité du racisme historique lié à la colonisation et à l’esclavage.

Profilage racial

Disparités ethnoculturelles
Les disparités ethnoculturelles renvoient à un ensemble d’inégalités observées entre différents groupes ethnoculturelles dans divers domaines de la vie sociale, économique, éducative et sanitaire. Plusieurs disparités ethnoculturelles associées à la santé mentale des communautés noires sont identifiées par les chercheurs et rapports d’organismes comme : un niveau plus élevé de discrimination liée à la santé mentale, un faible diagnostique des troubles anxieux chez les populations noires… La pandémie de Covid-19 a révélé certaines disparités ethnoculturelles au Canada d’après les études de Miconi et ses collaborateurs (2021). Les participants noirs, arabes et sud-asiatiques avaient un niveau de prévalence plus élevé face à la Covid-19 par rapport aux participants anglophones par exemple.

Méfiance envers le système biomédical
Elle désigne le sentiment de gêne, d’hésitation ou de réticence à consulter un professionnel de la santé. Cette méfiance découle souvent de la peur d’être incompris·e, jugé·e et ou de recevoir un diagnostic déconnecté du vécu personnel et du sens culturellement situé de la souffrance. Quelques discours illustrent bien cette méfiance : « ils vont penser que je suis fou, ne vont pas me comprendre, n’a pas le même vécu que nous, ils s’en foutent de notre souffrance … ».

Intériorisation des stigmas
C’est le processus involontaire à partir duquel une personne ou un groupe en vient à adopter et intégrer des jugements sociaux négatifs issus de la discrimination et de la stigmatisation. L’intériorisation de ces croyances, vécues comme étant vraies, influence les comportements, les émotions et l’image de soi de la personne. Les stigmas deviennent alors des cadres de références à partir desquels la personne ou le groupe, se perçoit et construit ses relations avec les autres. Par exemple, beaucoup de personnes noires ont intériorisé l’idée qu’elles sont très résilientes, ce qui les pousse souvent à garder leur souffrance en silence.

Les effets du racisme ordinaire sur la santé mentale des personnes noires -Marcilene Silva da Costa

Racisme intériorisé: le poids du silence en France

« Les gars ne pleurent pas » - Ose changer la narration -

« Prie seulement » - Ose changer la narration -

« Parler à un psy c'est pour les faibles » - Ose changer la narration

« On est résilient ? » - Ose changer la narration -

« Les problèmes, on garde ça en famille» - Ose changer la narration -

Vidéos en swahili

Vidéos en créole

Vidéos en lingala

